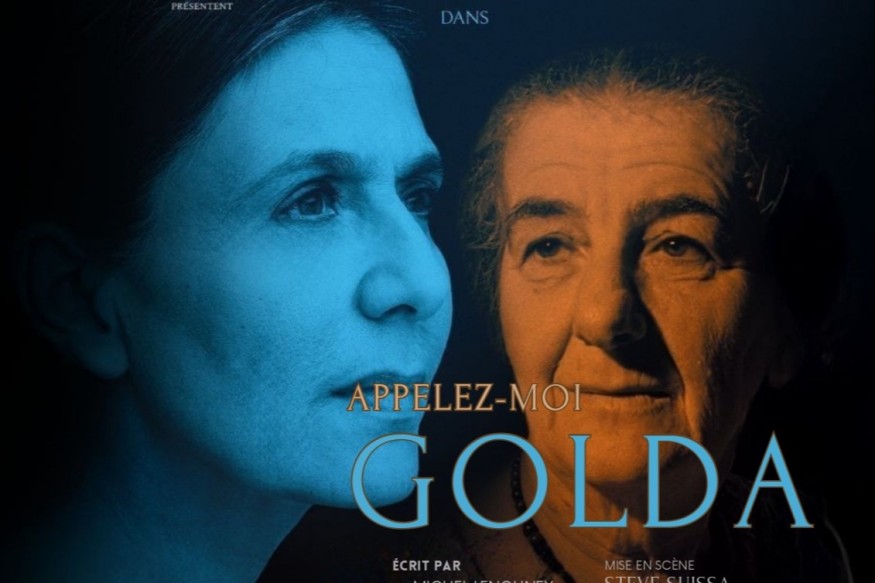04 avril 2024

Le 4 avril 2017, Sarah Halimi, directrice de crèche à la retraite vivant dans son appartement de la rue de Vaucouleurs, dans le XIe arrondissement de Paris, était battue à mort et défenestrée. Si son meurtrier a été jugé irresponsable pénalement en 2021, le caractère antisémite de son acte a été retenu, et cette terrible affaire bouleverse toujours, six ans plus tard, la communauté juive. Entretien avec le sociologue Michel Wieviorka, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales et spécialiste de l’antisémitisme.
Six ans après l’assassinat de Sarah Halimi, comment expliquer son retentissement au sein de la communauté juive française ?
Il tient d’abord et avant tout aux réticences, c’est le moins que l’on puisse dire, de la justice à prendre en compte la dimension antisémite de ce crime. Ensuite, aux difficultés que le monde juif a eues à faire comprendre à l’opinion plus générale, aux médias, qu’il s’agissait d’une affaire importante, grave et lourdement lestée d’antisémitisme. Il y a eu un sentiment d’incompréhension, d’ignorance. Mais aussi le sentiment de ne pas être respecté, de ne pas être compris, d’être menacé et qu’on traite uniquement comme relevant de la psychiatrie quelqu’un qui relève avant tout de l’antisémitisme. Les juifs de France sont très attachés à l’idée républicaine. Chaque fois qu’ils ont le sentiment que la République ne les protège pas suffisamment et ne fait pas bien son travail ou qu’elle risque de ne pas bien le faire, ils se mobilisent et ils s’inquiètent. L’affaire Sarah Halimi a fortement activé ces sentiments, mais ils ressurgissent aussi dans d’autres circonstances, comme en ce moment avec le procès de l’attentat de la rue Copernic, survenu en octobre 1980.